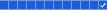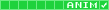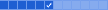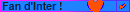http://www.leparisien.fr/magazine/grand ... 101157.phpInternational : les oubliés du « modèle » allemand
Derrière les bons chiffres de l’emploi cités en exemple se cache une forte précarité. Le social est l’un des principaux sujets de débat, outre-Rhin
Avec une balance commerciale excédentaire, un budget équilibré et un taux de chômage (5,4 %) très inférieur à celui de ses voisins, l’Allemagne est incontestablement la « locomotive » économique de l’Europe. En France, le pays dirigé par Angela Merkel – favorite des élections législatives du 22 septembre – est souvent présenté comme un « modèle » à suivre pour faire reculer le chômage et relancer la croissance.
Pourtant, la médaille du succès a un revers : « La précarisation de l’emploi s’est accentuée ces dernières années, au point qu’une partie de la population est exclue de la bonne santé économique du pays », résume l’économiste Thorsten Schulten.
Un chiffre pourrait résumer la situation outre-Rhin : 15,8 % de la population y vit sous le seuil de pauvreté, contre 14 % en France.
Des enjeux sociaux sensibles, comme l’absence d’un salaire minimum ou le développement des « mini-jobs », se sont invités dans la campagne électorale : Bas salaires (2,5 millions d’Allemands travaillent pour moins de 5,50 euros brut de l’heure), temps partiels imposés aux femmes (46 % ne sont pas à temps plein, contre moins de 30 % en France), généralisation des « mini-jobs » (7 millions de contrats précaires payés moins de 450 euros par mois) ou baisse des pensions de retraite (en moyenne 1 190 euros par mois, contre 1 470 euros en France)...
De Hanovre à Berlin, nous avons rencontré des Allemands qui témoignent des limites du « modèle ».
Mini-job : « Dès qu’on réclame, on est licencié »
Andreas Döhnert, 57 ans, agent de nettoyage à Berlin.
Du lundi au vendredi, Andreas Döhnert, 57 ans, fait le ménage de 14 à 22 heures dans un groupe scolaire de Berlin. Il a décroché ce CDI à temps plein l’année dernière. « Mais les 1 050 euros net de ce travail ne me suffisent pas pour vivre correctement », explique ce père de trois enfants.
Il exerce donc, en plus, un ‘‘mini-job’’ : cette formule de contrat de travail à temps partiel, dont la rémunération est plafonnée à 450 euros par mois, concerne 7 millions de personnes en Allemagne et, pour plus de 2,5 millions d’entre eux, s’ajoute à un travail salarié.
Depuis huit ans, Andreas couple ainsi temps plein et mini-jobs. Deux à trois jours par semaine, il travaille aussi dans des maisons de retraite, des bureaux ou des bâtiments publics.
« J’ai de la chance, je suis encore en bonne santé », sourit le quinquagénaire.
Mais la précarité du « mini-job », il connaît : « Ça me permet de boucler mon budget, mais la plupart des entreprises pensent qu’un mini-jobbeur n’a droit ni aux suppléments de nuit ou de week-end ni aux congés payés, déplore le Berlinois.
Dès qu’on réclame, on est licencié. Alors, pour ceux qui n’ont que ça, c’est dur ! En signant leur contrat, beaucoup de collègues en mini-jobs n’osent même pas demander à quel salaire horaire revient le forfait de 450 euros divisé par le nombre d’heures travaillées. »
Les mini-jobs sont pourtant légion dans le secteur d’Andreas Döhnert : « Depuis seize ans que je travaille dans le nettoyage, je n’ai eu que deux CDI à temps plein. Dans cette branche, il n’y a presque plus que des CDD et des mini-jobs. »
Travail des femmes : « Difficile d’être mère et de travailler à plein temps »
Sophie Lüttich, 36 ans, salariée à temps partiel à Berlin.
– Maurice Weiss Elle travaille aujourd’hui trente heures par semaine comme chargée de communication, avec un salaire « relativement confortable ». Mais avant d’avoir son fils Maximilian, en 2007, Sophie Lüttich, 36 ans, avait un travail à temps plein. « J’étais chef d’une équipe de huit personnes dans un département de marketing », précise-t-elle.
Après un an de congé parental, une durée normale en Allemagne, Sophie voulait d’abord un temps partiel mais espérait revenir à plein temps (40 heures par semaine), aux 2 ans de son fils. « Ma chef n’a pas voulu, explique-t-elle. Elle avait prévu de me laisser à mi-temps au prétexte que “la plupart des femmes font comme ça. Ensuite, on a oublié de m’inviter aux réunions. On pensait qu’elles avaient lieu trop tard pour une femme avec des enfants ! »
Sophie est née dans l’ex-Allemagne de l’Est, avant la chute du Mur. Elle a donc gardé à l’esprit sa propre mère comme modèle de femme au travail. « Elle était ingénieur et a toujours travaillé à plein temps, avec quatre enfants. Et je n’ai jamais eu l’impression qu’elle se soit moins bien occupée de nous pour autant. »
Déçue par l’attitude de sa chef, Sophie décide de changer d’emploi après son deuxième congé parental.
Aujourd’hui, son fils aîné se prépare à entrer à l’école primaire et sa fille Henriette, 2 ans et demi, va au jardin d’enfants.
« Nous avons eu beaucoup de chance avec eux. Comme ils sont tous les deux nés en septembre, nous avons obtenu une place en jardin d’enfants dès qu’ils ont eu un an. En milieu d’année, c’est très difficile de trouver une place libre, même à Berlin. »
Dans la capitale allemande, les jardins d’enfants sont gratuits à partir de 3 ans. Mais il s’agit d’une exception en Allemagne, où il n’existe pourtant pas d’écoles maternelles. Avant cet âge, le coût de la garde en jardin d’enfants dépend des revenus des parents. « Je paie 180 euros par mois, soit autant que ce que je reçois en allocations familiales, souligne Sophie. Mais je ne pense pas seulement en termes de coût immédiat. Le travail est très important pour ma retraite et la suite de ma carrière. »
Bas salaires : « Pendant cinq ans, j'ai travaillé pour à peine 6 euros de l’heure ! »
Uwe Schmidt, 53 ans, chômeur à Hanovre.
« J’étais payé 6 euros brut de l’heure », rapporte Uwe Schmidt. « Même pas ! », corrige sa femme : « 5,80 euros, pour être exact. »
Uwe et Angela Schmidt (le nom a été changé) reçoivent dans la maison qu’ils ont rénovée dans un village planté au milieu des champs, à 50 kilomètres d’Hanovre. A 53 ans, Uwe vient tout juste d'être licencié à la suite d’un congé maladie jugé « trop long ». Il travaillait depuis cinq ans dans une petite entreprise de recyclage, où il collectait vêtements et chaussures usagés déposés dans des conteneurs. « Je commençais à 5 heures du matin, finissais normalement à 13 h 45. Mais le chef trouvait toujours des raisons pour nous faire faire des heures supplémentaires, non payées. »
Pour son temps plein de quarante heures par semaine, Uwe touchait 934 euros brut par mois, comme le montre la dernière fiche de paie qu'il exhibe. Soit 640 euros net après prélèvement des cotisations sociales et des impôts sur le revenu (pris à la source en Allemagne). « C’est peu, mais je ne voulais pas me retrouver Hartz IV » – l’équivalent allemand du RSA (revenu de solidarité active) français.
Uwe Schmidt a commencé à travailler à 15 ans, enchaînant les métiers de couvreur, ouvrier de voirie ou agricole. Père de deux filles de 23 et 18 ans, il n’est jamais resté longtemps au chômage. « Mais c’est plus difficile aujourd’hui de trouver du travail. Surtout quand je dis mon âge... »
Le quinquagénaire est pourtant un homme mince et musclé qui semble encore en forme. Même s'il sort de l'hôpital pour une tendinite au coude qui lui a coûté son travail. Dans quelques jours, à la fin de son congé maladie, il veut chercher un emploi moins dur physiquement. « Dans le gardiennage, par exemple. » En attendant, c’est son épouse qui rapporte la plus grande partie de l’argent du foyer.
A 44 ans, Angela travaille depuis six ans comme aide-soignante dans une maison de retraite. En faisant des nuits, des week-ends et des semaines chargées, elle arrive à gagner jusqu'à 2 400 euros brut par mois, soit 13,37 euros de l’heure. « Comme ma femme gagne correctement sa vie, j’aurai droit à moins d’allocations chômage », déplore le mari, les yeux baissés.
Retraites : « Après quarante ans de travail, ma pension est sous le seuil de pauvreté »
Bergit Falter, 68 ans, retraitée à Hambourg.
Bergit Falter habite un petit deux-pièces dans le centre de Hambourg. La retraitée de 68 ans a eu la chance de trouver ce modeste appartement au loyer modéré dans un complexe de logements sociaux pour femmes seules retraitées. « J’ai emménagé il y a dix ans alors que je travaillais encore et que mes revenus dépassaient le plafond », reconnaît-elle.
Car à l’époque, Bergit savait qu’elle allait devoir vite prendre sa retraite à la suite d’importants problèmes de santé. Partie à 62 ans avec une hanche artificielle, ses revenus ont été divisés par deux. « Dans les dernières années de ma vie active, je gagnais 2 200 euros par mois. »
Elle touche aujourd’hui une retraite de base de 877 euros. Grâce à deux petites pensions complémentaires pour lesquelles elle a longtemps cotisé, elle arrive à 1 100 euros par mois. « Je ne suis pas pauvre, mais après quarante ans de travail, ma pension de retraite est sous le seuil de pauvreté ! C’est un scandale. »
Bergit est entrée sur le marché du travail dès l’âge de 14 ans, comme apprentie vendeuse, et n’en est sortie que pour passer son bac, une fois trentenaire, et faire des études en travail social. Elle a ensuite été vendeuse dans l’industrie, travailleuse sociale, directrice d’association, puis travailleuse indépendante dans le social. « Le travail a toujours été très important dans ma vie », explique cette femme divorcée et sans enfants.
Heureusement, sa longue carrière lui a aussi permis de faire quelques économies. « Avec ma seule retraite, je ne pourrais pas aller voir mes amis qui habitent dans le sud de l’Allemagne, payer la redevance audiovisuelle, l’assurance responsabilité civile ou la piscine. Car tout augmente ! » Comme son loyer, qui est passé de 380 à 420 euros par mois en quelques années.
Alors OK le chômage est bas et l'économie est en bonne santé. Mais à quel prix...