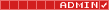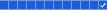Elle a regardé chacun des 49 coaccusés qui, à la suite de son ex-mari, se sont succédé à la barre pour raconter comment, une ou plusieurs fois, ils s’étaient emparés de son corps inerte, «comme si j’étais une poupée de chiffon». Elle les a écoutés durant des heures. Et n’a pas accepté les excuses tentées par certains. «Ce sont des violeurs, ils violent. Point. Quand ils s’excusent, en fin de compte, ils s’excusent eux-mêmes», tranchait-elle à la barre à mi-parcours. Face à leurs contorsions pour se disculper, elle lève parfois les yeux au ciel, s’agace à voix basse, ou plaque la tête contre le mur lorsque la cour diffuse les images de leur visite d’un ou plusieurs soirs, alors qu’elle était endormie par de puissants sédatifs administrés par son mari.
Long processus
Une seule fois, Gisèle Pelicot a quitté brièvement la salle d’audience, ulcérée par l’attitude de l’un d’eux. Sinon, elle a assisté à presque toutes les audiences, à l’exception du lundi, consacré à son rendez-vous chez le psychiatre. Ses enfants, présents les premiers jours jusqu’à leur audition, ont dû repartir en région parisienne. Elle s’est organisée pour suivre le procès, hébergée dans une maison d’amis où ses proches se relaient pour l’entourer. Sur le banc des parties civiles, elle n’est pas seule : deux professionnelles de l’Amav-France, l’association de médiation et d’aide aux victimes, suivent les audiences à ses côtés et l’accompagnent lors des pauses dans la salle de repos aménagée par le tribunal, lui permettant d’éviter de croiser les accusés qui comparaissent libres. «Gisèle Pelicot pourrait ne même pas venir», rappelle l’un de ses avocats, Antoine Camus. Etre là, c’est le message qu’elle a décidé de porter dès le premier jour d’audience, au nom de toutes les victimes de violences sexuelles : «Je veux qu’elles se disent que si madame Pelicot l’a fait, on peut le faire. La honte, ce n’est pas à nous de l’avoir, c’est à eux.» La plupart des observateurs saluent son courage, sa dignité. «J’exprime surtout ma volonté et ma détermination pour qu’on change cette société», corrige-t-elle.
Il a fallu un long processus pour qu’elle accepte d’endosser ce rôle, et une décision déterminante, actée par la cour à sa demande à l’issue d’un débat tendu : écarter le huis-clos autour du procès, à rebours de l’attitude particulièrement discrète de la désormais septuagénaire depuis la révélation des faits. Lorsque les premiers articles sur son histoire paraissent, plus d’un an avant le procès, elle est horrifiée, écœurée par l’étalement de sa vie privée, se souvient son avocat Antoine Camus. Lorsqu’elle les mandate en novembre 2022, lui et son confrère pénaliste Stéphane Babonneau, elle vient de congédier sa précédente avocate qui s’était exprimée dans les médias, parfois sans son accord. Dans le même temps, sa fille Caroline Darian publie un livre qui divise la famille. La quadragénaire, elle-même victime de celui qu’elle appelle désormais son «géniteur» – les enquêteurs ont retrouvé des photos d’elle en sous-vêtements dans l’ordinateur de son père –, s’est lancée dans le combat contre la soumission chimique en créant une association, M’endors pas, certaine d’avoir été elle aussi droguée. Mère et fille affrontent le même chaos, mais à des rythmes différents : «Caroline est alors dans un besoin viscéral de tout savoir, comme pour expulser toute cette horreur, là où Gisèle, tout en comprenant ce besoin de vérité, voulait préserver son intimité de mère, poursuit Me Camus. Elle était en colère parce qu’elle ne voulait pas qu’on parle d’elle, elle avait honte.»
Au printemps 2024, lorsque les dates d’audience du procès sont enfin annoncées, Gisèle Pelicot n’a lu que très peu de procès-verbaux du dossier d’instruction, vu que quelques images. «Notre angoisse est double à ce moment-là, rembobine son avocat. Elle est dans le déni, et on va être, avec ce procès, les instruments d’un choc psychologique. On lui dit que ça ne va pas être possible, avec ou sans publicité des débats, de ne pas regarder ces vidéos avant. On voulait au moins qu’avec nous, elle voie le pire.» Un visionnage est organisé au cabinet parisien de l’avocat avant l’été. Un point de bascule, assure Antoine Camus : «Elle était ulcérée, elle a vraiment pris conscience de ce qui se jouait dans ces vidéos, à quel point elle n’était plus rien.» La colère qui supplante la honte, l’engagement public de sa fille contre la soumission chimique, finissent de la convaincre : «C’est là qu’elle a commencé à évoquer la levée du huis-clos. On lui a demandé de réfléchir. Il ne s’est pas passé vingt-quatre heures avant qu’elle nous rappelle pour nous donner sa décision : c’était tout réfléchi, elle n’y reviendrait pas. C’était de l’indignation : “Regardez ce qu’ils m’ont fait.” Il fallait que les gens voient.»
Des courriers par centaines
En matière de huis-clos dans les affaires de viol, c’est la décision des parties civiles de rendre publics ou non les débats, qui est généralement suivie par la cour. Si le huis-clos est effectivement écarté au premier jour d’audience, il faudra attendre trois semaines et une décision collégiale de la cour à l’issue d’un débat contradictoire pour que le président Roger Arata, très réticent, valide définitivement la possibilité pour le public et les journalistes d’assister à la projection des images des viols. Une décision capitale : en acceptant de livrer publiquement son intimité et les violences subies, Gisèle Pelicot devient le porte-voix des victimes qui brisent, avec elle, le silence. Les lignes d’écoute comme celles du Collectif féministe contre le viol, du Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, mais aussi le 3919, le numéro national Violences femmes info, en perçoivent les effets directs. «On a, depuis le démarrage du procès, plus d’appels de femmes sur la question de la soumission chimique, mais aussi davantage sur le viol conjugal de manière générale», constate Mine Günbay, directrice générale de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), sans pouvoir, pour l’heure, le chiffrer.
Des milliers de manifestantes ont donné à voir, dans les rues de plusieurs villes, ou à Mazan même le 5 octobre, l’étendue du retentissement de ce procès. Au palais de justice d’Avignon, dès le petit matin, ils sont encore une bonne centaine, en majorité des femmes, à patienter chaque jour pour assister aux débats depuis la salle de retransmission. Scrutant chaque passage de Gisèle Pelicot, la foule se presse au milieu du hall. Composant une haie d’honneur, le public l’applaudit, les «mercis» résonnent, certains la filment.
De New York à Paris, le nom de Gisèle Pelicot s'affiche sur de nombreux collages féministes. Ici un collage en référence au procès, à Avignon le 10 octobre. (Christophe Simon/AFP)
Celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer lui écrivent, des courriers par centaines parfois simplement adressés à «Madame Gisèle Pelicot, Mazan» et redirigés vers le tribunal. Gisèle Pelicot les lit tous, assure son avocat, plutôt après l’audience, lorsqu’elle est seule. Des encouragements et des remerciements, des témoignages aussi, «qui la bouleversent», témoignent ses avocats. Certains soutiens viennent de loin, comme ces deux amies ayant conduit toute la nuit depuis la Suisse pour assister à l’audience, cette lettre envoyée depuis le Kurdistan irakien ou cette écharpe de soie offerte par un groupe de femmes australiennes. Un intérêt international qui se traduit sur les bancs des médias. Etats-Unis, Mexique, Allemagne, Australie, Japon… Des journalistes du monde entier se pressent à l’audience. Sur les 138 médias accrédités fin octobre, 57 étaient étrangers.
«Dimension sacrificielle»
Au fur et à mesure des semaines, Gisèle Pelicot a pris conscience de ce qu’elle représente, du statut d’icône féministe – certains diront même d’«héroïne» – qu’elle a acquis malgré elle. Ce sont sûrement les rues qui le racontent le mieux. Celles de New York où son nom s’affiche sur un collage féministe, en miroir de celles d’Avignon devenues un espace d’expression libre en son soutien. Mais aussi celles de Paris, Lille ou Lyon, où les street-artistes ont stylisé sa silhouette. «On pourrait presque en faire un pictogramme, le combo coupe et lunettes suffisent à la rendre reconnaissable», soulevait sur France 3 l’artiste Maca dessine, qui a réalisé une fresque à Gentilly (Val-de-Marne).
Ses lunettes de soleil rondes aux verres fumés, «Gisèle», comme l’appellent désormais ses soutiens, ne les porte plus depuis plusieurs semaines dans l’enceinte du tribunal. Dans la salle des pas perdus, sa cadence s’est ralentie. Elle sourit désormais plus franchement, envoie des baisers, accepte les bouquets de fleurs comme celui offert par son ancien professeur d’art dramatique, pose sous les collages féministes devant le palais de justice. Elle s’attarde même parfois auprès du public pour glisser quelques mots. La première fois que le tribunal a diffusé les images de ses viols, c’est même elle qui a pris le temps de réconforter un groupe d’adolescentes éprouvées, croisées au feu rouge près du palais de justice. «Elle se sent une responsabilité très claire aujourd’hui», remarque Antoine Camus. «Ces marques de soutien essentielles pour elle, ça l’aide à tenir, surtout à l’issue d’audiences éprouvantes, y compris physiquement», abonde Stéphane Babonneau, son autre avocat. Qui s’en inquiète un peu : «Le soir, il y a le cafard… La dimension sacrificielle, je ne sais pas si elle va l’avoir jusqu’au bout.»
Eriger une victime au rang d’icône n’est pas sans risque. «C’est lourd de porter la voix de toutes ces femmes. Il ne faut pas non plus que ce statut d’héroïne soit récupéré par les politiques et camouflent la réalité de tout le reste des violences», reconnaît Mine Günbay. Cette héroïsation bâtit un cadre et alimente (souvent sans le vouloir) l’idée de la «bonne» et de la «mauvaise» victime. Il y aurait celles qu’on admire, qui ne craquent pas, prennent soin de leur apparence, celles que l’on voudrait exemptes de tout reproche. Et les autres, celles qui perdent pied, s’expriment mal, celles qui ont fait des erreurs. Etre lestée du poids du symbole revient à quitter le seul statut de victime, à être scrutée doublement.
«Elle se dit qu’elle a gagné»
«Les victimes choisissent rarement elles-mêmes d’être ces icônes-là, bien que Gisèle Pelicot a inscrit d’emblée son procès dans un combat collectif. Ce sont souvent d’autres femmes qui ont besoin de se raccrocher à des modèles d’identification, ce qui est important pour avancer», constate la directrice générale de la FNSF Mine Günbay. Si le procès de Bobigny sur le droit à l’avortement en 1972 et celui d’Aix-en-Provence en 1978 sur le viol ont davantage été incarnés par l’avocate Gisèle Halimi que par les victimes elles-mêmes, Gisèle Pelicot est aujourd’hui le visage de son propre combat. Mine Günbay convoque Simone de Beauvoir : «Se vouloir libre, c’est vouloir les autres libres.» Et de poursuivre : «Elle nous rend toutes libres de quelque chose. A travers sa propre libération, sa propre sortie de ses violences, c’est toutes les femmes qu’elle emmène avec elle. Quand l’expérience personnelle prend une dimension collective, c’est pour moi l’incarnation du féminisme.» Antoine Camus nuance : «Gisèle Pelicot ne raisonne pas en termes de pouvoir. Mais c’est vrai, elle se dit qu’elle a gagné. Son obsession, c’est que ce procès serve à quelque chose. Parce qu’à titre personnel, que voulez-vous qu’elle en attende ? Rien. Elle a 71 ans, cinquante ans de sa vie se sont écroulés, même si elle a décidé d’en garder les jours heureux.»
Gisèle Pelicot s’attarde parfois auprès du public pour glisser quelques mots, de remerciement voire de réconfort. (Anna Margueritat/Anna Margueritat)
Au moins voudrait-elle comprendre. Elle l’a expliqué mi-octobre, lors de sa troisième audition devant les juges : «Comment ce mari, qui était l’homme parfait, a pu en arriver là ? Comment ma vie a pu basculer ?» Puis, pour la première fois, elle s’était adressée à «Dominique» – jusqu’ici, il était «monsieur Pelicot» : «Comment tu as pu laisser entrer chez nous ces individus ? Pour moi, cette trahison-là, elle est incommensurable…» Une «énigme», a reconnu l’expert-psychiatre Paul Bensussan, qui tente une explication à la barre : Dominique Pelicot aurait deux faces. Face B, celle qu’explore le tribunal, il est cet homme rongé d’addictions sexuelles, traquant sur Internet des partenaires pour assouvir ses besoins ou les pratiques que lui refusait son épouse.
Gisèle Pelicot, elle, ne connaissait jusqu’en 2020 que la face A. Lorsqu’elle rencontre Dominique, elle n’a que 20 ans, lui 19. Elle tombe instantanément sous le charme de ce «séduisant jeune homme aux cheveux longs» au volant de sa 2 CV rouge. «On n’avait pas d’argent, mais on était follement amoureux, on n’avait plus envie de se quitter», dit-elle à la cour. Ils se marient deux ans plus tard en 1973 et s’installent ensemble. Gisèle rêvait d’être coiffeuse mais débute comme sténodactylo avant de rejoindre EDF, où elle fera toute sa carrière, gravissant les échelons jusqu’à occuper le poste de chargée d’affaires. Celle de Dominique est plus chaotique : électricien de formation, il change plusieurs fois de métier, crée sa propre société, connaît des difficultés financières qui poussent même le couple à divorcer, en 2001. Sans interrompre leur vie commune : durant toutes ces années, Gisèle et Dominique font front commun, «toujours en soutien l’un pour l’autre», assure-t-elle encore. Elle est encore là lorsque son mari lutte contre un cancer, en 2007 – cette année-là, ils se remarient.
Appelé à la barre, leur entourage confirme le récit de ce couple uni, cette image de «famille idéale» qui n’explosera qu’après l’arrestation du retraité. Un mari prévenant et un père attentif, «un homme sain, bienveillant», se remémorait encore leur fille Caroline, devenu par la suite un grand-père «attentionné» avec ses sept petits-enfants. «C’était la maison du bonheur», témoigne Pascale, une très proche amie de Gisèle qui a fréquenté le couple jusqu’au début des années 2000.
L’illusion de la famille fonctionnelle, pour ne pas dire idéale, perdurera des années. Des soupçons d’un comportement incestueux de Dominique Pelicot envers ses petits-enfants ont pourtant émergé durant le procès, qu’il a toujours niés. Le couple est alors installé à Mazan depuis 2013 pour profiter de la retraite. Un nouveau point d’ancrage, où enfants et petits-enfants gravitent en particulier durant les vacances. Dominique fréquente un club sportif et sillonne le Vaucluse à vélo. Gisèle, elle, opte pour la randonnée et chante dans une chorale. Le couple reçoit régulièrement leurs enfants et petits-enfants. La vie paisible sous le soleil, dans la petite maison avec piscine, louée tout proche du centre-ville, jusqu’à ce que les premières «absences» ne bouleversent tout. Un coup de fil, un passage chez le coiffeur, un vêtement acheté la veille… Il y a comme un brouillard épais qui floute le quotidien de Gisèle. Au fil des mois, ses incohérences se multiplient. Un soir, elle s’effondre même en pleine soirée devant des amis.
«Elle a toujours été une femme forte»
Pour préserver son mensonge, Dominique Pelicot a forgé une explication : c’est le «stress», la fatigue générée par les allées et venues de sa femme à Paris pour s’occuper de ses petits-enfants. Gisèle, elle, craint un début d’Alzheimer ou une tumeur au cerveau, mais les nombreux médecins qu’elle consulte, toujours accompagnée de Dominique, ne décèlent rien. Aucun soignant n’envisage une soumission chimique. Bien plus tard, les analyses toxicologiques réalisées sur ses cheveux révéleront les fortes doses d’anxiolytiques que lui administrait son mari à son insu.
Les médicaments sont cachés dans une coupe de glace servie devant la télé, ou dans des purées qu’il prend soin de lui concocter. «Elle nous disait “j’ai de la chance, il me prépare tout”», s’est rappelée à la barre l’une de ses belles-filles, Céline Pelicot. Un mari tellement prévenant, qui prend son quotidien en main pour mieux le contrôler. Ses proches s’inquiètent : la sexagénaire se renferme sur elle-même, redoute désormais la moindre sortie, ne conduit plus depuis qu’elle a frôlé l’accident. «Avant 2013 et leur installation à Mazan, ma belle-mère était une femme indépendante, elle travaillait, avait ses activités, sortait, prenait soin d’elle», décrit Céline Pelicot. Face à l’insistance d’avocats de la défense, soucieux de recueillir le moindre signe d’un Dominique Pelicot manipulateur, Caroline Darian, la fille du couple, a elle aussi recadré : «Ma mère n’était pas sous l’emprise de mon père, elle allait quand elle voulait voir ses enfants en région parisienne, elle faisait des balades, du shopping. Elle n’était pas sous cloche.»
Encore moins une femme «soumise». «C’est même l’inverse», a abondé Dominique Pelicot lui-même devant les juges. «Elle a toujours été une femme forte, confirme Antoine Camus. La meilleure preuve, c’est qu’elle a quitté le domicile conjugal.» Cette aventure avec un collègue ingénieur, entamée dans la foulée de la naissance de leur cadet Florian en 1986, ne sera qu’une parenthèse. Gisèle choisit de rester au côté de son mari, à qui elle pardonne aussi ses quelques infidélités officielles. Elle ne partira pas non plus lorsque celui-ci lui annonce en larmes, en octobre 2020, qu’il s’est fait attraper par la police en filmant sous les jupes des femmes dans un supermarché de Carpentras. La plainte de l’une des victimes permettra la saisie de son matériel informatique et déclenchera son arrestation pour viols, quelques semaines plus tard.
«Dans la famille, on cache ses larmes et on partage ses rires»
Durant la période où elle est hébergée chez son fils aîné David, quelques mois seulement après la révélation des violences subies, Gisèle Pelicot s’attelle à «garder l’image d’une femme forte, d’une battante devant ses petits-enfants», décrit Céline Pelicot. Alors elle sort régulièrement leurs chiens : dehors, elle peut baisser les armes. Elle peut «crier», laisser s’«exprimer sa colère», raconte sa belle-fille. Gisèle a appris dès l’enfance à accuser les coups. Fille d’un militaire de carrière, elle n’a que 9 ans quand sa mère meurt d’un cancer. «Mon père n’a pas baissé les bras, c’est un boxeur, comme moi. […] J’ai compris alors que ma vie ne serait pas comme celle des autres.» A 19 ans, elle doit encore surmonter la perte de son frère aîné, mort d’un infarctus. «Dans la famille, on cache ses larmes et on partage ses rires», résume-t-elle un jour devant la cour.
«Elle est un exemple de résilience, même si le terme est galvaudé. Quand on a un truc comme ça qui vous tombe dessus, il faut continuer à marcher. C’est une rencontre qui a changé ma vie», assure Antoine Camus, qui s’apprête à prendre la parole avec Stéphane Babonneau pour la plaidoirie des parties civiles. Après eux, l’avocat général livrera ses mises en accusation, puis les nombreux conseils de la défense occuperont la barre, reparlant d’intentionnalité, de violeurs qui n’ont pas violé, de simulation de sommeil ou de jeux libertins. La cour criminelle se retirera ensuite pour délibérer. Les verdicts sont attendus avant Noël.
La suite, Gisèle Pelicot ne l’a pas évoquée avec ses avocats. «Elle avance pas à pas, mais je pense qu’elle aura envie de passer à autre chose, suggère Antoine Camus. Elle sait qu’elle a une responsabilité, elle n’entend pas s’y dérober. Elle devra peut-être raconter qui elle est, avant, peut-être, de disparaître.» Lundi 18 novembre à la barre, son fils cadet de 38 ans, Florian, observait : «Souvent dans ces grandes histoires criminelles, le nom qu’on retient c’est celui du méchant. Celui de Gisèle Pelicot, c’est pas du tout la même chose. A posteriori, je veux que mes enfants soient fiers de porter ce nom.» En reprenant ce patronyme pour la durée du procès, l’intéressée a renversé le stigmate. Même si la décision visait d’abord à préserver l’anonymat de son nom de naissance, qu’elle s’est réapproprié il y a quatre ans, et sa vie d’après. Fin octobre à la barre, Gisèle Pelicot avait confié : «Je ne sais pas comment je vais me reconstruire. A bientôt 72 ans, je ne sais pas si ma vie me suffira pour me relever.»