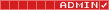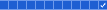La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 dite loi ÂŦ Fauchon Âŧ, a prÃĐcisÃĐ les conditions dâengagement
de la responsabilitÃĐ pÃĐnale des ÃĐlus :
Lorsquâils sont mis en cause, les ÃĐlus locaux le sont le plus souvent pour des infractions non
intentionnelles, soit parce quâils ont concouru à crÃĐer la situation à lâorigine du dommage en
usant de leur pouvoir dâadministrateur ou dâorganisateur, soit parce quâils nâont pas pris les
mesures qui auraient permis de prÃĐvenir le dommage.
Lâarticle L2123-34 du CGCT modifiÃĐ par la loi ÂŦ Fauchon Âŧ prÃĐvoit que sous rÃĐserve des
dispositions du quatriÃĻme alinÃĐa de l'article 121-3 du code pÃĐnal, le maire ou un ÃĐlu municipal le
supplÃĐant ou ayant reçu une dÃĐlÃĐgation ne peut Être condamnÃĐ sur le fondement du troisiÃĻme
alinÃĐa de ce mÊme article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions
que s'il est ÃĐtabli qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compÃĐtences,
du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultÃĐs propres aux missions que la
loi lui confie.
Ce rÃĐgime, rÃĐsultant de la loi Fauchon prÃĐcitÃĐe a ainsi entendu limiter les cas dâengagement de la
procÃĐdure de responsabilitÃĐ pÃĐnale des ÃĐlus.
Les principaux dÃĐlits non intentionnels entrant dans le champ dâapplication de cette loi sont :
- lâhomicide et blessures involontaires ;
- la mise en danger dâautrui ;
- les atteintes à lâenvironnement.
Lâhomicide involontaire est dÃĐfini comme le fait de causer la mort dâautrui par maladresse,
imprudence, inattention, nÃĐgligence ou manquement à une obligation de sÃĐcuritÃĐ ou de prudence
imposÃĐe par la loi ou le rÃĻglement. Il est puni de 3 ans dâemprisonnement et 45 000 euros
dâamende. En cas de violation manifestement dÃĐlibÃĐrÃĐe dâune obligation particuliÃĻre de sÃĐcuritÃĐ
ou de prudence imposÃĐe par la loi et les rÃĻglements, les peines encourues sont portÃĐes à 5 ans
dâemprisonnement et 75 000 euros dâamendes.
La responsabilitÃĐ des ÃĐlus locaux peut Être engagÃĐe dans diffÃĐrents secteurs dâactivitÃĐs relevant de
leurs fonctions administratives. Ainsi, pourront Être engagÃĐes :
- la responsabilitÃĐ liÃĐe au pouvoir de police administrative gÃĐnÃĐrale,
- la responsabilitÃĐ liÃĐe au pouvoir de police administrative spÃĐciale 1 ,
- la responsabilitÃĐ liÃĐe à la gestion des biens et services publics : a cet ÃĐgard, les maires
des communes de montagne supportent des obligations particuliÃĻres en matiÃĻre de
rÃĐglementation des conditions dâutilisation des pistes de ski.
La mise en danger dâautrui consiste dans le fait dâexposer directement autrui à un risque
immÃĐdiat de mort ou de blessures de nature à entraÃŪner une mutilation ou une infirmitÃĐ
permanente par la violation manifestement dÃĐlibÃĐrÃĐe dâune obligation particuliÃĻre de sÃĐcuritÃĐ ou
de prudence imposÃĐe par la loi et les rÃĻglements. Elle est punie dâun an dâemprisonnement et de
15 000 euros dâamende.
1 Voir fiche police
Les atteintes à lâenvironnement peuvent Être imputÃĐes au maire dans le cadre de lâexercice de
son autoritÃĐ de police sanitaire. Depuis la loi Fauchon, un ÃĐlu ne peut cependant Être condamnÃĐ
quâen cas de faute caractÃĐrisÃĐe (par exemple en cas de mauvais entretien dâune station
dâÃĐpuration, ou en matiÃĻre de gestion de lâeau potable en cas de non respect des pÃĐrimÃĻtres de
protection ou la mauvaise conservation des ouvrages).
En revanche, les dÃĐlits intentionnels nâentrent pas dans le champ dâapplication de la loi
ÂŦ Fauchon Âŧ parmi ces dÃĐlits peuvent Être citÃĐs :
- des manquements au devoir de probitÃĐ : la concussion, la corruption passive et le trafic
d'influence ou encore la prise illÃĐgale dâintÃĐrÊts, le favoritisme, les faux en ÃĐcritures
publiques et les infractions en matiÃĻre ÃĐlectorale
- les abus dâautoritÃĐ : les atteintes à la libertÃĐ individuelle, les discrimination, les
atteintes à lâinviolabilitÃĐ du domicile et les atteintes au secret des correspondances.
3 : la protection des ÃĐlus :
Aux termes du quatriÃĻme alinÃĐa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiÃĐe,
portant droits et obligations des fonctionnaires, ÂŦ la collectivitÃĐ publique est tenue d'accorder sa
protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas oÃđ il fait l'objet de poursuites
pÃĐnales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractÃĻre d'une faute personnelle Âŧ.
Le Conseil d'Ãtat a considÃĐrÃĐ que cette protection fonctionnelle relÃĻve d'un principe gÃĐnÃĐral du
droit applicable à l'ensemble des agents publics, notamment des ÃĐlus locaux (5 mai 1971, Gillet).
Enfin, les articles L. 2123-34 (pour les communes), L. 3123-28 (pour les dÃĐpartements) et L.
4135-28, pour les rÃĐgions) du CGCT ont prÃĐvu, pour les ÃĐlus locaux, un dispositif identique Ã
celui existant au bÃĐnÃĐfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi de 1983.
Ainsi, l'article L. 2123-34 dispose que ÂŦ la commune est tenue d'accorder sa protection au maire,
à l'ÃĐlu municipal le supplÃĐant ou ayant reçu une dÃĐlÃĐgation ou à l'un de ces ÃĐlus ayant cessÃĐ ses
fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pÃĐnales à l'occasion de faits qui n'ont pas le
caractÃĻre de faute dÃĐtachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un ÃĐlu municipal
le supplÃĐant ou ayant reçu une dÃĐlÃĐgation agit en qualitÃĐ d'agent de l'Ãtat, il bÃĐnÃĐficie, de la part
de l'Ãtat, de la protection prÃĐvue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires Âŧ.
Cette protection constitue une obligation pour la collectivitÃĐ et donc un droit pour l'intÃĐressÃĐ. Elle
peut comporter le remboursement par la collectivitÃĐ Ã l'ÃĐlu de tous les frais engagÃĐs par lui pour
sa dÃĐfense : frais de dÃĐplacement engendrÃĐs par la procÃĐdure, frais d'avocat et condamnations
pÃĐcuniaires prononcÃĐes à l'encontre de l'ÃĐlu (Conseil d'Ãtat, 28 juin 1999, Menage). De plus, si
l'autoritÃĐ compÃĐtente nÃĐglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de maniÃĻre
insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature Ã
engager la responsabilitÃĐ de la collectivitÃĐ publique concernÃĐe. Toutefois, ces principes
s'appliquant aux personnes investies de l'autoritÃĐ publique protÃĻgent les ÃĐlus dans l'exercice de
leurs fonctions, sans prÃĐjudice des suites que pourrait entraÃŪner au titre de leur responsabilitÃĐ
civile le fait que la faute ait revÊtu un caractÃĻre personnel. Il appartient au juge administratif de
dÃĐterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour rÃĐpartir dÃĐfinitivement entre l'ÃĐlu
municipal et la collectivitÃĐ publique la charge de la rÃĐparation du prÃĐjudice causÃĐ Ã un tiers.
Ainsi, si une condamnation est prononcÃĐe pour faute personnelle, ledit ÃĐlu doit en supporter les
consÃĐquences (Conseil d'Ãtat, 27 avril 1988, commune de Pointe-à -Pitre). De mÊme, la
collectivitÃĐ publique qui a ÃĐtÃĐ condamnÃĐe par le juge à garantir la faute personnelle de l'ÃĐlu peut
se retourner contre lui (Conseil d'Ãtat, 28 juillet 1951, Laruelle). Enfin, il a ÃĐtÃĐ jugÃĐ que ÂŦ le
conseil municipal ne peut lÃĐgalement mettre à la charge du budget communal les frais exposÃĐs
pour la dÃĐfense du maire faisant l'objet de poursuites pÃĐnales que si les faits commis par le maire
ne sont pas dÃĐtachables de l'exercice de ses fonctions Âŧ (cour administrative d'appel de Bordeaux,
25 mai 1998, M. AndrÃĐ).