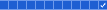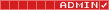Aujourdâhui encore, il joint sans cesse lâimage à la parole, accompagnant chaque pan de rÃĐcit dâune de ces photographies insoutenables fixÃĐes sur son tÃĐlÃĐphone, quâil fait dÃĐfiler sans automatisme, mais comme il mesurerait chaque fois le jaillissement de la mÃĐmoire à sa piÃĻce à conviction, avec une attention toujours aiguÃŦ à ce que lâon ne se contente pas dâentendre, ou de regarder. Il tient à ce que lâon voie. Des corps criblÃĐs de balles, brÃŧlÃĐs, dÃĐchiquetÃĐs, pulvÃĐrisÃĐs. Des corps dâenfants surtout, dont il dÃĐcrit et juge la destruction en termes pleins dâune exactitude sans affect, toute chirurgicale.
Parmi ses patients et les victimes portÃĐes mortes jusquâà lâhÃīpital, les trÃĻs jeunes enfants ÃĐtaient surreprÃĐsentÃĐs, explique Mark Perlmutter, parce que leurs corps sont plus vulnÃĐrables, mÊme trÃĻs loin du point dâimpact des explosifs. ÂŦOn peut se disputer sur les mots, gÃĐnocide, ÃĐlimination ciblÃĐe dâune population pour sâemparer de son territoire, peu importe comment vous voulez nommer le largage dâune bombe amÃĐricaine dâune tonne sur un campement de tentes, alors quâelle fut conçue pour dÃĐtruire un bunker dix mÃĻtres sous terre. Quand elle frappe un simple campement, les shrapnels et lâonde de choc portent beaucoup plus loin. Un jour, une bombe a frappÃĐ assez prÃĻs de lâenceinte de lâhÃīpital pour faire tomber les dalles du plafond, briser les vitres. On ÃĐtait à environ un kilomÃĻtre, et jâai ÃĐtÃĐ projetÃĐ si fort contre le mur que je me suis cassÃĐ une dent et lâindex. Quâarrive-t-il à un bÃĐbÃĐ Ã 400 mÃĻtres ? Ses membres sont arrachÃĐs, son cerveau et lâintÃĐrieur de sa poitrine rÃĐduits en bouillie. Et, je vais vous montrer lâimage, mais vous nâimaginez pas ce que ça fait de voir un bÃĐbÃĐ coupÃĐ en deux et de savoir que vos impÃīts ont payÃĐ lâarme qui a fait ça.Âŧ
Sur lâitinÃĐraire du retour, rÃĐempruntant le passage de Rafah vers lâEgypte, il sera saisi par la vision des centaines de camions immobilisÃĐs là , moteurs ÃĐteints, bardÃĐs de provisions et dâaide humanitaire pourrissant sur place, ÂŦles mÊmes, lui sembla-t-il, que lâon sâÃĐtait rÃĐjoui de voir à lâaller, et auxquels sâÃĐtaient ajoutÃĐs une masse dâautresÂŧ. Câest comme ça, ÂŦen en parlant sur le long trajet vers Le Caire, quâon a rÃĐalisÃĐ que lâinformation ne sortait pas plus que les vivres nâentraient, quâil nous fallait nous faire journalistes pour aller au bout de notre mission. Parce que notre boulot, câest de guÃĐrir en retirant un mal. Mais comment mener à bien cette tÃĒche sur ce que nous avons abandonnÃĐ derriÃĻre nous, avec la conscience dâavoir laissÃĐ un enfant qui aurait dÃŧ recevoir dix opÃĐrations encore, alors que personne ou presque nâest plus là pour le faire, parce que lâhÃīpital a ÃĐtÃĐ fermÃĐ depuis, et les soignants sont pris pour cibles ?Âŧ Sa voix sâÃĐtrangle. ÂŦÃa nâest pas ma vocation, pas mon mÃĐtier de faire le reporter. Mais je ne peux pas sauver la vie de ces enfants si je ne vous transmets pas la vÃĐritÃĐ, ce que jâai vu.Âŧ
ÂŦLe pire journalisme que jâai jamais vuÂŧ
Avec son confrÃĻre californien Feroze Sidhwa, il cosigna donc une tribune confiÃĐe à Politico. On les convia à la tÃĐlÃĐvision, oÃđ CBS a ÃĐdulcorÃĐ leur tÃĐmoignage, au titre quâil serait diffusÃĐ le dimanche matin, et leur passage fin juillet sur CNN a tournÃĐ au vinaigre. InvitÃĐs dâune prestigieuse ÃĐmission du week-end, ils y relataient le dÃĐfilÃĐ de corps de bÃĐbÃĐs en charpie, le constat implacable que des gosses ÃĐtaient visÃĐs par des snipers (ÂŦIl nây avait aucun doute, assÃĻne Mark Perlmutter, on ne tire pas par hasard sur un enfant deux fois de suite, dans le cÅur puis la tÊteÂŧ), le calvaire dâun mÃĐdecin palestinien victime dâabus, tortures et mutilationsâĶ A deux reprises, la prÃĐsentatrice aura jugÃĐ bon de glisser la mention que les autoritÃĐs militaires israÃĐliennes niaient ou refusaient de confirmer de telles ÂŦallÃĐgationsÂŧ, que ÂŦCNN nâa pu vÃĐrifier indÃĐpendammentÂŧ. A la fin, le chirurgien a lÃĒchÃĐ avec amertume : ÂŦCâÃĐtait le pire journalisme que jâai jamais vu.Âŧ
ÂŦElle sâest exclamÃĐe : âPardon ?â se souvient-il. Mais je ne pouvais pas ne pas lui rÃĐpondre : âVous minimisez, mettez en cause ce que je dis.â Mais quand quinze mÃĐdecins qui en reviennent dÃĐcrivent la mÊme chose, ce quâil faudrait remettre en question, ce nâest pas ce quâils dÃĐnoncent mais le fait quâil vous soit impossible dâentrer vous-mÊmes à Gaza. Ãa nous oblige, nous soignants, à faire ce travail de journaliste à votre place.Âŧ LâÃĐchange sera coupÃĐ au montage.
Sa vie est en vrac, il y a ÃĐgarÃĐ de proches amis, a ÃĐtÃĐ reniÃĐ par des pans de sa famille majoritairement juive, a vu dâestimÃĐs confrÃĻres le rayer de leur cercle social. Il a reçu des menaces, des mails haineux, des messages anonymes qui lui notifient quâil est ÂŦsur la listeÂŧ. Il a tout de mÊme pris ses billets pour le Liban, en janvier. ÂŦTous ces gens, dont jâai cru quâils ÃĐtaient mes amis, me reprochent de âfaire de la politiqueâ, et moi je voudrais ne surtout pas en faire, mais je crois quâon ne peut pas y ÃĐchapper si lâon fait de la santÃĐ mondiale une cause et une communautÃĐ.Âŧ Sur cette trame de tourments, quelques joyeuses nouvelles ont fleuri malgrÃĐ tout â des cancers surmontÃĐs autour de lui, une naissance prochaine, le retour dâune personne aimÃĐe. Mais, alors que la plupart des ÃĐlus amÃĐricains sollicitÃĐs ont fait la sourde oreille, le Dr Perlmutter dit nâavoir rien connu de plus heureux cette annÃĐe dans sa vie que dâavoir vu son ÂŦtÃĐmoignage Être prÃĐsentÃĐ au Parlement britannique et contribuer ainsiÂŧ, en septembre, à la suspension de certaines exportations dâarmes vers IsraÃŦl.