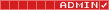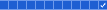Marine Le Pen sur TF1 aprÃĻs son inÃĐligibilitÃĐ :
7 affirmations passÃĐes au crible
Reçue sur la premiÃĻre chaÃŪne, quelques heures aprÃĻs le jugement sur les assistants fictifs du FN du Parlement europÃĐen, la responsable dâextrÊme droite a multipliÃĐ les approximations sur sa condamnation.
Câest le visage fermÃĐ et les dents serrÃĐes que Marine Le Pen a ÃĐcoutÃĐ le journaliste Gilles Bouleau, lundi soir sur TF1, ouvrir son journal de 20 heures en rappelant sa condamnation, plus tÃīt dans la journÃĐe, par le tribunal correctionnel de Paris, dans lâaffaire des assistants parlementaires europÃĐens : quatre ans de prison dont deux ferme, 100 000 euros dâamende et cinq ans dâinÃĐligibilitÃĐ avec exÃĐcution provisoire, pour ÂŦdÃĐtournements de fonds publicsÂŧ. Fonds en lâoccurrence europÃĐens, la responsable de lâextrÊme droite française et 24 autres membres du RN ÃĐtant accusÃĐs dâavoir utilisÃĐ, entre 2004 et 2016, leurs assistants au Parlement europÃĐen pour des fonctions au sein du Front national (devenu depuis Rassemblement national).
Visiblement marquÃĐe par la sentence, Marine Le Pen va alors multiplier, durant les treize minutes que durera lâÃĐchange avec le journaliste, les approximations et les contre-vÃĐritÃĐs, face à un Gilles Bouleau moins au fait du dossier quâil ne le prÃĐtend.
Passage en revue des principales rÃĐÃĐcritures du jugement par la dÃĐputÃĐe RN.
ÂŦUne dÃĐcision politiqueÂŧ
Marine Le Pen : ÂŦJâai parfaitement compris [que la prÃĐsidente] ÃĐtait en train de rendre une dÃĐcision qui ÃĐtait une dÃĐcision politique : la magistrate a assumÃĐ trÃĻs clairement de mettre en Åuvre lâexÃĐcution provisoire de lâinÃĐligibilitÃĐ, câest-à -dire en rÃĐalitÃĐ de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour mâempÊcher de me prÃĐsenter et dâÊtre ÃĐlue, dit-elle, à lâÃĐlection prÃĐsidentielle.Âŧ
Cette affirmation est un (gros) raccourci.
Dans leur dÃĐlibÃĐrÃĐ, les magistrats font bien allusion à son ÃĐventuelle ÃĐlection, mais pour expliquer quâen lâabsence dâexÃĐcution provisoire, celle-ci permettrait à Marine Le Pen dâÃĐchapper à sa condamnation dâinÃĐligibilitÃĐ pour dÃĐtournements de fonds publics : ÂŦLe tribunal prend en considÃĐration, outre le risque de rÃĐcidive, le trouble majeur à lâordre public dÃĐmocratique quâengendrerait en lâespÃĻce le fait que soit candidat [e], par exemple et notamment à lâÃĐlection prÃĐsidentielle, voire ÃĐlue, une personne qui aurait dÃĐjà ÃĐtÃĐ condamnÃĐe en premiÃĻre instance, notamment à une peine complÃĐmentaire dâinÃĐligibilitÃĐ, pour des faits de dÃĐtournements de fonds publics et pourrait lâÊtre par la suite dÃĐfinitivement.Âŧ Et les juges de poursuivre : ÂŦIl sâagit ainsi pour le tribunal de veiller à ce que les ÃĐlus, comme tous justiciables, ne bÃĐnÃĐficient pas dâun rÃĐgime de faveur, incompatible avec la confiance recherchÃĐe par les citoyens dans la vie politique. DÃĻs lors, dans le contexte dÃĐcrit, eu ÃĐgard à lâimportance de ce trouble irrÃĐparable, le droit au recours nâÃĐtant pas un droit acquis à la lenteur de la justice, il apparaÃŪt nÃĐcessaire selon le tribunal, à titre conservatoire, dâassortir les peines dâinÃĐligibilitÃĐ prononcÃĐes de lâexÃĐcution provisoire.Âŧ
Une ÂŦinÃĐligibilitÃĐ immÃĐdiate contrairement à lâEtat de droitÂŧ
Marine Le Pen : ÂŦLa prÃĐsidente dit : ÂŦJe vais rendre votre inÃĐligibilitÃĐ immÃĐdiateÂŧ, contrairement à lâEtat de droit, parce quâen France lorsque vous faites appel, lâappel est suspensif, lâappel annule en rÃĐalitÃĐ le jugement de premiÃĻre instance vous remet dans la situation dâÊtre prÃĐsumÃĐ innocent et lâaffaire est rejugÃĐe.Âŧ
Le caractÃĻre ÂŦimmÃĐdiatÂŧ de son inÃĐligibilitÃĐ, via lâexÃĐcution provisoire, nâest en rien ÂŦcontraireÂŧ Ã lâEtat de droit.
LâexÃĐcution provisoire est une disposition du code de procÃĐdure pÃĐnale qui est rÃĐguliÃĻrement prononcÃĐe dans le cadre dâune dÃĐcision de premiÃĻre instance.
Et elle est complÃĻtement applicable à lâinÃĐligibilitÃĐ (articles 471, alinÃĐa 4, du code de procÃĐdure pÃĐnale et 131-10 du code pÃĐnal).
En outre, lâappel nâa pas pour effet dâannuler le jugement de premiÃĻre instance, mais de le suspendre le temps que la cour dâappel rende son arrÊt. Laquelle cour ne repart pas de zÃĐro, mais confirme ou infirme, en tout ou partie, la dÃĐcision rendue en premiÃĻre instance.
ÂŦLa juge considÃĻre que le fait de se dÃĐfendre justifie lâexÃĐcution provisoireÂŧ
Le Pen : ÂŦ[La juge] considÃĻre que le fait de se dÃĐfendre justifie lâexÃĐcution provisoire. [âĶ] On nous dit le fait de vous dÃĐfendre, le fait de faire ÃĐtat, potentiellement de la prescription qui serait intervenue, va faire en sorte que je vais aggraver de maniÃĻre considÃĐrable votre peine au point de vous empÊcher de pouvoir Être ÃĐlue.Âŧ
Marine Le Pen fait ici allusion au fait que sa dÃĐfense ait ÃĐtÃĐ interprÃĐtÃĐe par les juges comme un risque de rÃĐcidive, justifiant, entre autres, lâexÃĐcution provisoire. La prÃĐsidente a en effet expliquÃĐ que la maniÃĻre dont les accusÃĐs se sont dÃĐfendus a bien dÃĐmontrÃĐ quâils ne se remettaient pas du tout en cause, ne saisissaient pas la gravitÃĐ de leurs actes et ne reconnaissaient absolument pas leurs fautes. Les prÃĐvenus ont aussi manifestÃĐ leur refus du dÃĐbat contradictoire, en cherchant à sâÃĐcarter du dÃĐbat au fond, niant lâÃĐvidence, jusquâà leurs propres ÃĐcritsâĶ Certains ont mÊme fabriquÃĐ de faux documents à prÃĐsenter à la justice pour contester les faits. Ce qui caractÃĐriserait le risque de rÃĐcidive, et donc justifierait lâexÃĐcution provisoire, en plus du trouble à lâordre public dÃĐjà ÃĐvoquÃĐ plus haut dans cet article.
ÂŦ
La loi Sapin, qui entraÃŪne lâapplication automatique de lâexÃĐcution provisoire à lâinÃĐligibilitÃĐ, a ÃĐtÃĐ ÃĐcartÃĐeÂŧ
Marine Le Pen: ÂŦLa loi Sapin 2, contrairement à ce que jâai entendu beaucoup aujourdâhui, ne sâapplique pas à cette affaire. La loi Sapin, qui entraÃŪne lâapplication automatique de lâexÃĐcution provisoire à lâinÃĐligibilitÃĐ, a ÃĐtÃĐ ÃĐcartÃĐe par la magistrate car cette loi est postÃĐrieure aux faits qui nous sont reprochÃĐs.Âŧ
Marine Le Pen a raison (et Gilles Bouleau tort) sur un point :
les juges ne se sont pas appuyÃĐs sur la loi Sapin 2 dans leur dÃĐcision, les faits incriminÃĐs ÃĐtant antÃĐrieurs à son entrÃĐe en vigueur (11 dÃĐcembre 2016). En revanche, ce que la loi Sapin 2 a rendu ÂŦ
obligatoireÂŧ (
et non automatique, car il est possible dây dÃĐroger),
câest lâinÃĐligibilitÃĐ en cas de dÃĐtournements de fonds par des personnes exerçant un mandat ÃĐlectif (article 131-26-2 du code pÃĐnal), et non pas son exÃĐcution provisoire, comme le dit Marine Le Pen.
Lâarticle 471 du code de procÃĐdure pÃĐnale, qui est antÃĐrieur à la loi Sapin, liste les peines qui ÂŦpeuvent Être dÃĐclarÃĐes exÃĐcutoires par provisionÂŧ. Et câest le cas, entre autres, de lâinterdiction dâexercer une profession, la suspension du permis de conduire, ou lâinÃĐligibilitÃĐ.
ÂŦ
La juge a appliquÃĐ lâesprit dâune loi postÃĐrieure plus dure, câest une violation de lâEtat de droitÂŧ
Marine Le Pen : ÂŦAu moment oÃđ je vous parle, la prÃĐsidente du tribunal a condamnÃĐ la favorite à lâÃĐlection prÃĐsidentielle à cinq ans dâinÃĐligibilitÃĐ avec exÃĐcution provisoire sans motivation. Elle lâa dit trÃĻs clairement, [la loi Sapin 2] ne sâapplique pas. En revanche elle a appliquÃĐ lâesprit dâune loi postÃĐrieure plus dure, câest encore une violation de lâEtat de droit.Âŧ
Comme Marine Le Pen le dit elle-mÊme, les juges, encore une fois, ne se sont pas appuyÃĐs sur la loi Sapin 2 pour prononcer son inÃĐligibilitÃĐ. Mais ce qui ne veut pas dire que leur dÃĐcision ne repose sur aucun texte. Depuis une loi du 23 juillet 1992, la peine dâinÃĐligibilitÃĐ pouvait dÃĐjà Être prononcÃĐe quand une personne dÃĐpositaire de lâautoritÃĐ publique ÃĐtait condamnÃĐe pour avoir dÃĐtournÃĐ des fonds publics (ou plus largement pour tout manquement à son devoir de probitÃĐ). Elle nâavait juste pas de caractÃĻre obligatoire. Marine Le Pen et ses coaccusÃĐs ont donc ÃĐcopÃĐ dâune peine dâinÃĐligibilitÃĐ conformÃĐment au droit antÃĐrieur à 2016.
Ce à quoi fait allusion Marine Le Pen en parlant de lâapplication ÂŦdâune loi postÃĐrieure plus dureÂŧ, câest le fait que dans leur dÃĐlibÃĐrÃĐ, les magistrats ÃĐvoquent â en plus de la loi antÃĐrieure â la loi Sapin 2, soulignant quâils en ont suivi ÂŦlâespritÂŧ. Ce quâillustre notamment cette phrase du dÃĐlibÃĐrÃĐ : ÂŦSi la peine dâinÃĐligibilitÃĐ nâÃĐtait pas obligatoire à lâÃĐpoque des faits dont les prÃĐvenus sont dÃĐclarÃĐs coupable, les lois postÃĐrieures illustrent nÃĐanmoins la volontÃĐ du lÃĐgislateur de mieux sanctionner les manquements à la probitÃĐ pour restaurer la confiance des citoyens envers les responsables publics.Âŧ
ÂŦ
Un dÃĐsaccord administratifÂŧ
Marine Le Pen : ÂŦJe considÃĻre encore une fois que ce procÃĻs qui nous a ÃĐtÃĐ fait par des adversaires politiques [est] fondÃĐ sur des arguments qui ne tiennent pas la route, il sâagit là dâun dÃĐsaccord administratif avec le Parlement europÃĐen.Âŧ
Câest lâun des arguments les plus rabÃĒchÃĐs par le RN depuis le dÃĐbut de cette affaire des assistants fictifs : dire que le dossier ne tiendrait quâà une ÂŦdiffÃĐrence dâapprÃĐciationÂŧ du rÃĻglement du Parlement europÃĐen entre les cadres du Front national et le Parlement europÃĐen lui-mÊme. Marine Le Pen martÃĻle ainsi que les collaborateurs fictifs nâavaient pas lâobligation de travailler seulement pour leurs eurodÃĐputÃĐs durant leurs heures de travail, que lâinverse serait une ÂŦvision erronÃĐe du travail des dÃĐputÃĐs dâopposition et de leurs assistants, qui est avant tout politiqueÂŧ. Sauf que les rÃĻgles du Parlement europÃĐen sont claires : ÂŦUn assistant parlementaire accrÃĐditÃĐ ou local, doit se consacrer, durant ses heures de travail, exclusivement à un travail dâassistant parlementaire europÃĐen. [âĶ] Le Parlement est trÃĻs strict sur lâinterdiction pour lâassistant de rÃĐaliser du travail pour un parti politique dans le cadre de ses heures de travail financÃĐes par le Parlement europÃĐen.Âŧ
ÂŦ
Il nây a pas dâenrichissement personnel Âŧ
Marine Le Pen: ÂŦIl nây a pas dâenrichissement personnel, de corruption, il nây a rien de tout cela. On nous dit juste vos assistants parlementaires nâauraient pas dÃŧ faire de la politique avec vous et aurait dÃŧ exclusivement se contenter de faire des lois.Âŧ
Si Marine Le Pen a ÃĐtÃĐ condamnÃĐe pour ÂŦdÃĐtournement de fonds publicsÂŧ, câest notamment pour lâemploi fictif de deux de ses anciens assistants parlementaires accrÃĐditÃĐs : son ancienne cheffe de cabinet, Catherine Griset, et son garde du corps, Thierry LÃĐgier. La premiÃĻre est payÃĐe de 2010 à 2016 par lâEurope pour des tÃĒches de secrÃĐtariat pour la prÃĐsidente du FN, bÃĐnÃĐficiant en plus du statut dâexpatriÃĐe rÃĐservÃĐ aux assistants accrÃĐditÃĐs rÃĐsidant à Bruxelles, avec tous les avantages, notamment fiscaux, qui accompagnent la chose. Sauf quâelle vivait en rÃĐgion parisienne, et nâa jamais mis un orteil en Belgique, ou trÃĻs peu, malgrÃĐ lâobligation contractuelle pour un assistant accrÃĐditÃĐ de rÃĐsider dans lâun des trois sites du Parlement europÃĐen â Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg.
https://www.liberation.fr/checknews/mar ... B7T7UKOFU/