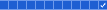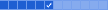LâindÃĐpendance du ÂŦ Monde Âŧ, un privilÃĻge et une responsabilitÃĐ
Un projet dâaccord garantit lâindÃĐpendance à long terme de la rÃĐdaction. LâÃĐditorial de JÃĐrÃīme Fenoglio, directeur du ÂŦ Monde Âŧ.
LE MONDE | 27.01.2017
Le groupe Le Monde vient dâouvrir un nouveau chapitre de lâhistoire de
son indÃĐpendance ÃĐditoriale. Les droits protÃĐgeant ses rÃĐdactions, adossÃĐs depuis des annÃĐes à une minoritÃĐ de blocage, ne dÃĐpendront plus dÃĐsormais de la part du capital dÃĐtenue par le PÃīle dâindÃĐpendance (regroupant sociÃĐtÃĐs de journalistes, de personnels, de lecteurs et de fondateurs). Selon le projet dâaccord avec les actionnaires majoritaires (Pierre BergÃĐ, Xavier Niel et Matthieu Pigasse) votÃĐ par le PÃīle le 12 janvier, ces protections seront dÃĐsormais inscrites dans les statuts mÊme de notre entreprise. InaliÃĐnables, accrus sur certains points, ces droits ne seront plus limitÃĐs dans le temps.
Ce mouvement renforce la place singuliÃĻre quâoccupe Le Monde dans lâhistoire de la presse française, et dans le paysage actuel des mÃĐdias. La dÃĐconnexion des droits politiques et moraux des journalistes de lâÃĐvolution du capital clarifie la rÃĐpartition des pouvoirs entre les deux parties. Garants de la bonne gestion du groupe, les actionnaires majoritaires, rassemblÃĐs dans la structure Le Monde libre, lui apportent, depuis 2010, les moyens de son dÃĐveloppement. Loin des logiques de prÃĐdation ou de dÃĐmantÃĻlement que lâon a pu voir à lâÅuvre dans dâautres mÃĐdias, les diffÃĐrents titres du groupe ont pu accomplir leur rÃĐvolution numÃĐrique. A rebours de la tentation de lâinformation low cost et des saignÃĐes dans les effectifs, la rÃĐdaction du Monde nâa perdu ni son ÃĒme ni sa substance. Elle sâest ÃĐtoffÃĐe pour investir de nouveaux champs de lâactualitÃĐ, pour explorer de nouvelles maniÃĻres de sâadresser à ses lecteurs, en restant fidÃĻle à son histoire, à son identitÃĐ et à sa tradition dâexcellence. Lâinformation nây a jamais ÃĐtÃĐ considÃĐrÃĐe comme un produit ou une simple source de profit.
Les journalistes conservent la pleine maÃŪtrise de leurs ÃĐcrits et de leur image, cette indÃĐpendance, dont le directeur est le garant, incluant notamment le recrutement des nouveaux membres de la rÃĐdaction.
Depuis 2010, cette sÃĐparation entre capital et rÃĐdaction nâa souffert aucune exception. De fait, trÃĻs peu de mÃĐdias, dans le monde, disposent dâune libertÃĐ aussi complÃĻte que la nÃītre. TrÃĻs peu de journalistes sont dÃĐfendus par une tradition et des mÃĐcanismes de protection aussi fermes que les nÃītres. TrÃĻs peu de journaux et de sites ont produit, ces derniÃĻres annÃĐes, autant dâenquÊtes et dâinformations inÃĐdites bousculant pouvoirs politiques et ÃĐconomiques, en France et à lâÃĐtranger.
Les ÃĐvÃĐnements des derniers mois lâont dÃĐmontrÃĐ Ã lâenvi : cette tradition dâun journalisme de grande qualitÃĐ nâa jamais ÃĐtÃĐ aussi nÃĐcessaire.
Dans le paysage de lâinformation mondiale, cette situation reprÃĐsente à la fois un privilÃĻge et une responsabilitÃĐ. Le plus grand danger serait de la considÃĐrer comme dÃĐfinitivement acquise. En matiÃĻre dâindÃĐpendance de la presse, notion ÃĐminemment instable, il nâexiste pas de risque zÃĐro. Aucune structure ÃĐconomique, aucun systÃĻme de protection, aucune charte ne peut garantir une rÃĐsistance totale à toute forme dâintervention, de jeu dâinfluence, de pression, si les principes ne sont pas soutenus par une vertu, individuelle et collective : le courage.
Collectivement, les rÃĐdactions ressemblent à des corps vivants, dotÃĐs dâune mÃĐmoire et de rÃĐflexes communs. En perdant le contrÃīle ÃĐconomique de son entreprise, à la fin des annÃĐes 2000, la rÃĐdaction du Monde nâa renoncÃĐ ni à cette culture dâindÃĐpendance, forgÃĐe par soixante-dix annÃĐes dâune histoire mouvementÃĐe, ni à cette capacitÃĐ de se mobiliser pour dÃĐfendre ses prÃĐrogatives. Elle a manifestÃĐ, depuis, lâune et lâautre à de multiples reprises. Sâil est entretenu, avec le soutien vigilant de nos lecteurs, cet hÃĐritage peut sâinscrire encore longtemps, au Monde, dans le prolongement moral et intellectuel de lâidÃĐal dâune information sans entraves, formÃĐ, au lendemain de la guerre, par son fondateur, Hubert Beuve-MÃĐry.
Les ÃĐvÃĐnements des derniers mois lâont dÃĐmontrÃĐ Ã lâenvi : cette tradition dâun journalisme de grande qualitÃĐ nâa jamais ÃĐtÃĐ aussi nÃĐcessaire. Aux peurs, aux rumeurs, aux mensonges, à la propagande, à la raison dâEtat, au ÂŦ storytelling Âŧ, elle oppose une pratique professionnelle, un savoir-faire indispensable pour permettre au public dâaccÃĐder rapidement à des informations impartiales, fiables, approfondies et mises en perspective.
A ce corpus de rÃĻgles, Le Monde a ajoutÃĐ
une charte de dÃĐontologie, discutÃĐe rÃĐguliÃĻrement au sein dâun comitÃĐ dâÃĐthique. Nombre dâusages anciens, comme la tenue rÃĐguliÃĻre de comitÃĐs de rÃĐdaction, organisÃĐs par sa SociÃĐtÃĐ des rÃĐdacteurs, ont retrouvÃĐ une nouvelle vigueur.
Lâinvestigation, une prioritÃĐ
De la mÊme maniÃĻre, des pratiques journalistiques essentielles à notre ÃĐpoque ont ÃĐtÃĐ relancÃĐes. Lâinvestigation est une prioritÃĐ, qui nous a permis de rÃĐvÃĐler nombre dâaffaires et de scandales, avec comme point dâorgue les publications des SwissLeaks ou des Panama Papers dans le cadre dâune collaboration avec des mÃĐdias du monde entier. Cette capacitÃĐ dâenquÊte, qui se diffuse dans toute la rÃĐdaction, sera encore renforcÃĐe, dans les mois qui viennent, dans le domaine ÃĐconomique. Sans cette volontÃĐ de dÃĐvoiler petits et grands dÃĐvoiements de nos sociÃĐtÃĐs, le journalisme manque à lâune de ses contributions majeures au bon fonctionnement de la dÃĐmocratie.
LâindÃĐpendance, câest aussi, dans une ÃĐpoque et une sociÃĐtÃĐ clivÃĐes, oÃđ lâon ne sâexprime plus que dâun seul point de vue ou dâun seul camp, lâambition de demeurer le lieu du dÃĐbat, en nous gardant de lâesprit de systÃĻme et de toute connivence. En cette annÃĐe ÃĐlectorale, câest encore de maintenir nos distances avec candidats ou partis, sans pour autant renoncer à nos valeurs. Ou enfin dâopposer à lâÃĐnervement gÃĐnÃĐralisÃĐ, à lâextension du culte du moi, au spectacle de la violence, au relÃĒchement de lâexpression, le calme et lâhumilitÃĐ dâune dÃĐmarche qui sâefforce de saisir la complexitÃĐ des choses, dâexpliquer sans caricaturer, de reconnaÃŪtre ses erreurs.
Fort de ces principes, notre groupe sâest placÃĐ en premiÃĻre ligne dans les batailles qui se sont ouvertes : celle des faits contre les manipulations, celle de la raison contre les dÃĐlires fanatiques, celle du dÃĐbat dÃĐmocratique contre le choc stÃĐrile des opinions. Dans ces combats, le journalisme fait souvent figure de premier ennemi à abattre, pour lui substituer une sociÃĐtÃĐ verrouillÃĐe, sans contradiction ni contre-pouvoir. Face à ces attaques, de plus en plus virulentes, nous ne nous dÃĐroberons pas. Nous maintiendrons, avec fiertÃĐ, mais sans arrogance, notre ambition de constituer un point de repÃĻre dans un monde dÃĐboussolÃĐ, confortÃĐe chaque jour par le plus prÃĐcieux des soutiens : la confiance de nos lecteurs.
Un modÃĻle ÃĐconomique ÃĐquilibrÃĐ
LâindÃĐpendance ÃĐditoriale du Monde repose sur un modÃĻle ÃĐconomique ÃĐquilibrÃĐ fondÃĐ sur plusieurs canaux de ressources, ce qui permet de nâÊtre dÃĐpendant dâaucun dâentre eux. Il y a dâabord nos lecteurs, quâils soient acheteurs du journal papier au numÃĐro ou abonnÃĐs à nos ÃĐditions papier ou numÃĐrique. Il y a ensuite la publicitÃĐ, dans le quotidien et notre magazine, et sur le numÃĐrique. Depuis quelques annÃĐes, ces recettes sont complÃĐtÃĐes par lâessor de nos activitÃĐs hors mÃĐdia (partenariats, confÃĐrences en France et à lâÃĐtranger, Le Monde festival).
Le Monde, comme les autres mÃĐdias français, sâappuie ÃĐgalement sur une sÃĐrie dâaides de lâEtat, certaines trÃĻs anciennes puisquâelles remontent à la crÃĐation du journal, dans lâimmÃĐdiat aprÃĻs-guerre. Ces aides nâentravent en rien notre indÃĐpendance ÃĐditoriale : elles ont ÃĐtÃĐ conçues pour quâun secteur dâactivitÃĐ trÃĻs fragile, et indispensable au fonctionnement de nos dÃĐmocraties, puisse fonctionner sans Être trop fortement soumis à un certain nombre dâalÃĐas ÃĐconomiques.
Ces aides peuvent Être indirectes : il sâagit pour lâessentiel de tarifs postaux dÃĐrogatoires et dâun certain nombre dâexonÃĐrations fiscales, dont le taux de TVA rÃĐduit à 2,1 %. Elles peuvent Être ÃĐgalement directes sous la forme dâune aide à lâexport, au portage ou au financement de projets de dÃĐveloppement, essentiellement numÃĐriques. Pour Le Monde, en 2016, le montant de ces aides publiques directes ÃĐtait de 2,6 millions dâeuros.
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/ ... dx4yDC2.99