il y aura juste a dÃĐpoussiÃĐrer la "reconquista"...barbara a ÃĐcrit : Tsunami anti-minarets en Europe : les sondages en ligne se suivent et se ressemblent.
Par Yann le 1 dÃĐcembre 2009
La votation suisse, un tournant majeur pour lâislam en Europe ? Câest en effet à une vÃĐritable dÃĐferlante islamorÃĐaliste que nous assistons en Europe depuis les rÃĐsultats de la votation suisse. La chape de plomb du politiquement correct se lÃĐzarde, les consciences se libÃĻrent, les langues se dÃĐlient. Force est de constater quâun abysse sÃĐpare la classe mÃĐdiatico-politique et les citoyens europÃĐens. La preuve par les sondages en ligne :
http://www.bivouac-id.com/2009/12/01/ts ... ssemblent/
les minarets aux urnes en Suisse
- gemmill
- Posteur DIVIN
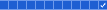
- Messages : 11943
- EnregistrÃĐ le : 10 avril 2008 20:17
Re: les minarets aux urnes en Suisse
si maupassant est devenu fou , c'est parce que il avait une conscience aigÞe de la matiÃĐre , du nÃĐant et de la mort.
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
- Fonck1
- Administrateur
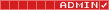
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
c'est quoi un avis politiquement incorrect sur cette question? la stigmatisation?barbara a ÃĐcrit :
Eh oui, on peut toujours occulter la rÃĐalitÃĐ en apposant des ÃĐtiquettes diffamantes sur ceux qui ÃĐmettent un avis politiquement incorrect. As-tu pris connaissance des sondages ou t'es-tu limitÃĐ Ã l'introduction?
le tiens provient d'un site oreientÃĐ affichÃĐ,il n'est pour moi pas objectif.quand aux sondages en ligne,je le rÃĐpÃĻte,il ne sont pas objectif.la toile rassemble plus de frustrÃĐ que la tierre entiÃĻre ne pourrait en porter.c'est n'est absolument pas objectif.Fonck, des sondages ÃĐmanant de "Le Monde", "l'Express", "Le Figaro", RMC et d'autre journaux sÃĐrieux europÃĐens. Tous subjectifs? Toi non plus tu n'as ouvert le lien.
tant que lo'on ne m'a pas filÃĐ un sondage a l'aveugle,sur X personnes de la population,par tÃĐlÃĐphone,sans distinction de choix,et encore il faudrait voir la nature des questions,aprÃĻs,peut Être je pourrais le prendre en considÃĐration.
maintenant,tout le monde sait que les sondage ne reprÃĐsentent que ceux qui les commandent.ca a assez coutÃĐ cher a l'ÃlysÃĐe...enfin au contribuable...
Le nationalisme c'est la guerre !
- Fonck1
- Administrateur
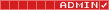
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
:roll: pauvre gemmil que ta vie doit Être triste.gemmill a ÃĐcrit : il y aura juste a dÃĐpoussiÃĐrer la "reconquista"...
Le nationalisme c'est la guerre !
- gemmill
- Posteur DIVIN
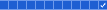
- Messages : 11943
- EnregistrÃĐ le : 10 avril 2008 20:17
Re: les minarets aux urnes en Suisse
comment le rÃĐve peut il Être triste ??Fonck1 a ÃĐcrit : :roll: pauvre gemmil que ta vie doit Être triste.
si maupassant est devenu fou , c'est parce que il avait une conscience aigÞe de la matiÃĐre , du nÃĐant et de la mort.
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
- Fonck1
- Administrateur
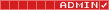
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
t'es plutÃīt dans le cauchemar la;sors vite de ce corps adolfe!gemmill a ÃĐcrit :
comment le rÃĐve peut il Être triste ??
Le nationalisme c'est la guerre !
- gemmill
- Posteur DIVIN
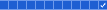
- Messages : 11943
- EnregistrÃĐ le : 10 avril 2008 20:17
Re: les minarets aux urnes en Suisse
c'est pas adolf , c'est ferdinand (et isabelle)...Fonck1 a ÃĐcrit : t'es plutÃīt dans le cauchemar la;sors vite de ce corps adolfe!
si maupassant est devenu fou , c'est parce que il avait une conscience aigÞe de la matiÃĐre , du nÃĐant et de la mort.
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
- Fonck1
- Administrateur
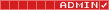
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
franz?gemmill a ÃĐcrit : c'est pas adolf , c'est ferdinand (et isabelle)...
Le nationalisme c'est la guerre !
- Fonck1
- Administrateur
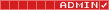
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
L'UDC veut dÃĐsormais instrumentaliser le thÃĻme du radicalisme de l'islam
Il ne manque plus que des ÃĐtoiles rouge,et c'est le bouquet hallal garni
Il n'ÃĐtait pas l'un des promoteurs de l'initiative sur l'interdiction de construire des minarets, mais Christoph Blocher, l'ancien homme fort de l'Union dÃĐmocratique du Centre (UDC) et ancien conseil fÃĐdÃĐral (ministre), dit maintenant vouloir pousser l'avantage. Sur les ondes de la radio zurichoise Radio 1, M. Blocher, aujourd'hui vice-prÃĐsident de l'UDC, a estimÃĐ que le prochain combat pourrait Être celui contre la burqa. Et que viendraient ensuite les mariages forcÃĐs, l'excision et les discriminations envers les femmes.
Le nationalisme c'est la guerre !
- tisiphonÃĐ
- Administrateur
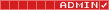
- Messages : 125660
- EnregistrÃĐ le : 19 septembre 2007 21:53
- Localisation : heavens above
- Contact :
Re: les minarets aux urnes en Suisse
M. Blocher, aujourd'hui vice-prÃĐsident de l'UDC, a estimÃĐ que le prochain combat pourrait Être celui contre la burqa. Et que viendraient ensuite les mariages forcÃĐs, l'excision et les discriminations envers les femmes.
qui y trouverait à redire si il n'ÃĐtait pas de l'UDC ?
nankurunaisa
- gemmill
- Posteur DIVIN
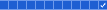
- Messages : 11943
- EnregistrÃĐ le : 10 avril 2008 20:17
Re: les minarets aux urnes en Suisse
je vais demander l'asile politique a la suisse... et toi fonck , je ne t'enverrais pas de chocolat ( mais plutot une grosse greta...  )
)
si maupassant est devenu fou , c'est parce que il avait une conscience aigÞe de la matiÃĐre , du nÃĐant et de la mort.
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
"extension du domaine de la lutte".michel houellbecq
- Jarod1
- Animateur
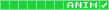
- Messages : 41523
- EnregistrÃĐ le : 24 avril 2008 14:05
Re: les minarets aux urnes en Suisse
Ils te refouleront à la frontiÃĻre, sale français de merde ! 

"disons que la chine est un pays particulier,c'est sur,tout le monde a du travail,et ceux qui ne savent rien faire au lieu d'attendre que ça passe balayent les autoroutes.
on ne sait pas trop à quoi ca sert,mais au moins,ils travaillent."
on ne sait pas trop à quoi ca sert,mais au moins,ils travaillent."
- Fonck1
- Administrateur
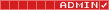
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
c'est plutot toi qui aura plus de chocolat,pour ton info,il est fabriquÃĐ en france le chocolat suisse... :roll:gemmill a ÃĐcrit : je vais demander l'asile politique a la suisse... et toi fonck , je ne t'enverrais pas de chocolat ( mais plutot une grosse greta...)
Le nationalisme c'est la guerre !
- Fonck1
- Administrateur
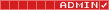
- Messages : 151027
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 5 fois
Re: les minarets aux urnes en Suisse
c'est bien le problÃĻme,ca commence comme ca avec ce type d'idÃĐes,et ca finit comme ca:tisiphonÃĐ a ÃĐcrit :
qui y trouverait à redire si il n'ÃĐtait pas de l'UDC ?

la frontiÃĻre est proche....c'est exactement le discours de hitler en 33....
on ne demande pas a un vendeur de soupe si ca soupe est bonne...
Le nationalisme c'est la guerre !
-
barbara
- Posteur TOP VIP
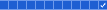
- Messages : 1898
- EnregistrÃĐ le : 25 janvier 2009 16:25
Re: les minarets aux urnes en Suisse
Ce site fait ÃĐtat de sondages rÃĐalisÃĐs par des medias variÃĐs qui reprÃĐsentent une diversitÃĐ d'opinions, je ne vois donc pas pourquoi ils ne seraient pas objectifs du fait que Bivouac s'y rÃĐfÃĻre.Fonck1 a ÃĐcrit : c'est quoi un avis politiquement incorrect sur cette question? la stigmatisation?
le tiens provient d'un site oreientÃĐ affichÃĐ,il n'est pour moi pas objectif.quand aux sondages en ligne,je le rÃĐpÃĻte,il ne sont pas objectif.la toile rassemble plus de frustrÃĐ que la tierre entiÃĻre ne pourrait en porter.c'est n'est absolument pas objectif.
tant que lo'on ne m'a pas filÃĐ un sondage a l'aveugle,sur X personnes de la population,par tÃĐlÃĐphone,sans distinction de choix,et encore il faudrait voir la nature des questions,aprÃĻs,peut Être je pourrais le prendre en considÃĐration.
maintenant,tout le monde sait que les sondage ne reprÃĐsentent que ceux qui les commandent.ca a assez coutÃĐ cher a l'ÃlysÃĐe...enfin au contribuable...
"Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas".
- tisiphonÃĐ
- Administrateur
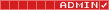
- Messages : 125660
- EnregistrÃĐ le : 19 septembre 2007 21:53
- Localisation : heavens above
- Contact :
Re: les minarets aux urnes en Suisse
L'appellation "chocolat suisse" jouit d'une protection spÃĐcifique. Un chocolat suisse doit en effet avoir ÃĐtÃĐ complÃĻtement fabriquÃĐ en Suisse. La sous-traitance à l'ÃĐtranger d'une des ÃĐtapes de sa fabrication doit Être mentionnÃĐe sur l'emballage du produit.Fonck1 a ÃĐcrit : c'est plutot toi qui aura plus de chocolat,pour ton info,il est fabriquÃĐ en france le chocolat suisse... :roll:
nankurunaisa