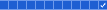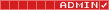Quand GisÃĻle Halimi affrontait la justice coloniale
Avec les accusÃĐs dâEl Halia
Lors des procÃĻs de Bobigny (1972) et dâAix-en-Provence (1978), GisÃĻle Halimi a mis en accusation les lois criminalisant lâavortement et sanctionnant insuffisamment le viol. Auparavant, lâindÃĐpendance de lâAlgÃĐrie et la dÃĐnonciation des tortures furent les grandes causes de lâavocate, morte le 28 juillet dernier.
par GisÃĻle Halimi
Samedi 20 aoÃŧt 1955 [dix mois aprÃĻs le dÃĐbut de la guerre dâAlgÃĐrie]. Midi. Le chef mineur Ferdinand Bertini et son fils se dirigent à motocyclette vers El Halia, un petit village situÃĐ Ã quelques kilomÃĻtres de Philippeville [aujourdâhui, Skikda]. Soudain, plusieurs coups de feu. Le fils est touchÃĐ au ventre, mais tous deux parviennent à rejoindre El Halia. Impossible de donner lâalerte. Les lignes tÃĐlÃĐphoniques sont coupÃĐes.
Dans le village, lâampleur du drame ÃĐclate. Ceux qui nâauront pas songÃĐ Ã se barricader nâÃĐchapperont pas au massacre. Dans les habitations et les locaux de la mine de fer, des insurgÃĐs brisent, pillent, incendient, assassinent à coups de fusil ou de revolver, sâaidant souvent de couteaux, de haches ou de pelles. MÊme tragÃĐdie aux ateliers oÃđ les ouvriers europÃĐens sont ÃĐgorgÃĐs. à quinze heures, deux avions militaires mitraillent le village. Peu aprÃĻs, arrivent les premiers parachutistes. Sâensuivit une terrible rÃĐpression. Selon des sources officielles, plus de mille AlgÃĐriens pÃĐrirent dans le Constantinois.
Le procÃĻs se dÃĐroula sur le thÃĐÃĒtre mÊme du drame, au plus profond de cicatrices encore bÃĐantes. DÃĻs notre arrivÃĐe, LÃĐo Matarasso et moi nous nous rendÃŪmes dans lâun des trois petits hÃītels de la ville susceptibles de nous hÃĐberger. Refus de nous accueillir. ÂŦ Les avocats parisiens des ÃĐgorgeurs dâEl Halia Âŧ â ainsi titrait la presse â ÃĐtaient indÃĐsirables. Le second hÃītelier nous laissa nous installer, puis, deux heures plus tard, nous pria de partir. Le dernier accepta de nous donner des chambres, aprÃĻs que nous eÃŧmes beaucoup insistÃĐ. Le surlendemain, vers cinq heures du matin, le patron nous demandait de quitter les lieux : ÂŦ Ils veulent entrer dans vos chambres, tout casser et mettre le feu à lâhÃītel si je vous garde, vous comprenezâĶ Âŧ
Le sous-prÃĐfet, auquel dÃĻs notre arrivÃĐe nous rendÃŪmes visite, triomphait : nous ÃĐtions avertis, il se trouvait dans lâincapacitÃĐ dâassurer notre sÃĐcuritÃĐ. Nous avions pris des risques, à nous de les assumer seuls. Le bÃĒtonnier de Philippeville se dÃĐsigna pour hÃĐberger LÃĐo. Un autre avocat fut ÂŦ rÃĐquisitionnÃĐ Âŧ pour me donner asile. Nos confrÃĻres ne nous conviÃĻrent pas une seule fois à leur table. La haine formidable de toute la ville nous submergeait. Nous nâÃĐtions pas la dÃĐfense mais les complices des tueurs.
Quarante-quatre accusÃĐs, trente autres jugÃĐs par contumace, cinquante tÃĐmoins, quinze avocats. Les CRS cernent le tribunal que prÃĐside le colonel Garraud. Magistrat de carriÃĻre rappelÃĐ sous les drapeaux, volontaire pour lâAlgÃĐrie, il se veut sec et impartial. De temps en temps pourtant, il apostrophera les dÃĐfenseurs. MÊmes rÃĐactions des onze juges. Sans aucune compÃĐtence juridique particuliÃĻre, ces officiers se contentaient de prÊter serment avant les dÃĐbats, pour dÃĐcider ensuite de la vie ou de la mort des dÃĐlinquants.
Le box ne peut contenir les accusÃĐs, alignÃĐs sur des bancs par rangs de cinq ou six. à leur cou, une plaque de bois portant un numÃĐro â 1 à 44. Ils risquent tous la peine de mort. Ils se regardent et regardent dans la salle. Ils y cherchent des parents, des amis. IndiffÃĐrents à la brutalitÃĐ des contrÃīles â des ordres, des tutoiements, des coups de crosse souvent â, ils attendent avec patience et gravitÃĐ. Tous les observateurs de la guerre dâAlgÃĐrie remarqueront la dignitÃĐ de ce comportement. Nous savions que les tÃĐmoignages nâavaient pu Être recueillis quâà partir dâaveux, tous confectionnÃĐs grÃĒce à la violence.
Comment lâenquÊte commença-t-elle ? Lâarrestation tardive des suspects nâavait rÃĐpondu quâà des nÃĐcessitÃĐs politiques. Faire une dÃĐmonstration de la force de la justice française et venger les morts europÃĐens. Pour trouver des coupables, on puisa dans les dÃĐnonciations, les racontars, et surtout dans les dossiers de police fichant certains de ces AlgÃĐriens comme nationalistes. DÃĻs le lendemain de lâÃĐmeute, le docteur Travail, mÃĐdecin lÃĐgiste local, fut chargÃĐ dâexaminer les cadavres, dâen faire la description et dâindiquer les causes de la mort. Ainsi, tel ÃĐtait dÃĐcrit comme tuÃĐ par balles, tel autre ÃĐgorgÃĐ, tel autre encore ÃĐventrÃĐ Ã coups de serpe, tel autre enfin mort le crÃĒne ÃĐclatÃĐ Ã la hache.
Par une sorte de distribution idÃĐale, chaque accusÃĐ reconnaissait avoir tuÃĐ telle ou telle victime. Et, avec une prÃĐcision peu commune, ils reprenaient, presque mot pour mot, les conclusions du docteur Travail sur les cadavres attribuÃĐs à chacun dâeux. Certains ajoutaient mÊme le dÃĐtail que seul le criminel peut connaÃŪtre et donc donner. Câest lâhistoire de la cicatrice, du tic, de la bizarrerie dâameublement, de langage, de comportement. Ce qui transforme une hypothÃĻse policiÃĻre en une vÃĐritÃĐ indiscutable. Dans les procÃĻs-verbaux, des dÃĐclarations pÃĐtries de spontanÃĐitÃĐ â telles que ÂŦ elle se dÃĐbattait, je lui ai brisÃĐ le brasâĶ Âŧ, ÂŦ il avait peur et il est allÃĐ se cacher sous le litâĶ Âŧ, ÂŦ le bÃĐbÃĐ, je lâai arrachÃĐ des bras de sa mÃĻreâĶ Âŧ â foisonnaient.
Le dÃĐfilÃĐ des tÃĐmoins commence. Le prÃĐsident baisse la voix : ÂŦ Vos nom, prÃĐnoms, qualitÃĐsâĶ
â Jâai vu Sehab SaÃŊd tuer ma mÃĻre avec un fusil de chasse. Puis il a tirÃĐ sur ma belle-sÅur dans le dos. Elle est morte presque aussitÃīt. Il a tirÃĐ sur ma sÅur Olga dans la poitrine. Elle est morte sur le coup. Puis mon petit frÃĻreâĶ Moi-mÊme jâai ÃĐtÃĐ blessÃĐe avant ma sÅur. Âŧ
La jeune femme qui parle avait dix-sept ans au moment des faits. En lâespace de quelques minutes, elle a vu mourir toute sa famille. Sa jeunesse, son maintien, ses mots donnent à sa prÃĐsence une telle force que personne nâose intervenir. La belle rescapÃĐe se tourne avec lenteur, avec hauteur, vers les bancs des accusÃĐs. Silence de mort. Elle tend le bras et pointe lâindex : ÂŦ Câest luiâĶ et lâautre, à cÃītÃĐâĶ je les reconnais. Âŧ Elle ne les avait identifiÃĐs jusque-là que sur photos, en lâabsence de toute confrontation. ÂŦ Jâen suis sÃŧre, mon regard a croisÃĐ le leurâĶ Âŧ Elle vient sans doute de condamner à mort deux hommes.
ÂŦ Pas de questions, maÃŪtre Matarasso, maÃŪtre Halimi ? Âŧ, interroge le prÃĐsident. Nous hÃĐsitons. Les accusÃĐs quâelle vient de dÃĐsigner disposent de sÃĐrieux alibis. Lâun dâeux se trouvait à deux cents kilomÃĻtres des lieux, le 20 aoÃŧt, et le bouclage opÃĐrÃĐ par lâarmÃĐe dans cette rÃĐgion ne permettait à personne â et encore moins à un AlgÃĐrien â des allÃĐes et venues. Des tÃĐmoins peuvent lâÃĐtablir. Est-elle si sÃŧre de sa dÃĐsignation ? ÂŦ Pas de questions Âŧ, laisse enfin tomber à mi-voix LÃĐo. Nous en sentons lâindÃĐcence, quelles quâelles soient. La jeune femme sâen va. Elle nous a rÃĐduits au silence.
Le rapport dâautopsie avait conclu pour quatre des victimes à une mort par objet tranchant. Couteau, serpe, hache. Les tÃĐmoins directs â pour la plupart parents proches â affirmÃĻrent, sous la foi du serment, que les ÃĐmeutiers tirÃĻrent à coups de pistolet ou de fusil de chasse. OÃđ est la vÃĐritÃĐ ? Pour leur part, les accusÃĐs, dotÃĐs de ces cadavres ambigus, reconnurent, avec quelques dÃĐtails, avoir tranchÃĐ Ã coups de serpe, fait ÃĐclater un crÃĒne à la hache, ÃĐgorgÃĐ au couteau. Sâil y avait bien eu mort par balles, quel sens prenaient ces aveux et surtout comment avaient-ils pu Être obtenus ?
Nous voulons une nouvelle autopsie, lâexhumation de ces quatre cadavres et la dÃĐsignation dâautres mÃĐdecins lÃĐgistes. Que lâexamen ÃĐtablisse lâerreur ou la faute du docteur Travail, et les aveux calquÃĐs sur le rapport deviennent la preuve dâun autre crime : la torture. Ã coup sÃŧr, lâaccusation perd du terrain. Si le premier rapport est vÃĐridique, les aveux collent mais les tÃĐmoins mentent. Ã lâinverse, si les tÃĐmoins disent la vÃĐritÃĐ, alors le docteur Travail nâa pas examinÃĐ les cadavres. Les accusÃĐs auraient donc avouÃĐ des actes que les constatations infirment. Ils se seraient chargÃĐs de meurtres particuliÃĻrement odieux sans les avoir commis.
Dans le dossier du 20 aoÃŧt 1955, ni piÃĻces à conviction, ni armes saisies, ni empreintes. Au moment oÃđ ils interrogent les suspects, les policiers ne disposent pas encore des tÃĐmoignages qui contrediront, plus tard, lâautopsie. Alors, ils foncent. Ces AlgÃĐriens doivent Être coupables. Comme ils nâen ont pas dâautres sous la main, ils entreprennent de leur arracher des aveux. Supplice de la baignoire, du courant ÃĐlectrique sur tout le corps, des brÃŧlures de cigarette sur les testicules. Le secret rÃĻgne, lâimpunitÃĐ semble assurÃĐe. Ils parviennent à leurs fins. Les suspects craquent, consentent, racontent. La machine à ÃĐcrire crÃĐpite. Les procÃĻs-verbaux, dont la police rÊvait, deviennent rÃĐalitÃĐ judiciaire. Les dÃĐclarations sâemboÃŪtent parfaitement et confirment le constat. ÂŦ Toi Nacer Ahmed tu as ÃĐgorgÃĐâĶ toi Benguettar Hocine tu as tirÃĐ Ã coups de chevrotine. Âŧ Nacer Ahmed, Benguettar Hocine, tous les autres acquiescent. Ils reconnaissent tout, et ce tout donne une pleine cohÃĐrence à lâenquÊte, du dÃĐbut jusquâà la fin. à chacun son cadavre, la distribution tient.
Le tribunal nous ÃĐcoute, agacÃĐ par la rationalitÃĐ de lâalternative que nous dÃĐveloppons. Ou bienâĶ ou bienâĶ AprÃĻs un court dÃĐlibÃĐrÃĐ, le prÃĐsident Garraud fait droit à nos conclusions. Le colonel parachutiste Lartigaud est dÃĐsignÃĐ pour examiner les corps des quatre victimes ÂŦ litigieuses Âŧ.
[Quelques jours plus tard]
ÂŦ Lâaudience est reprise, annonce le prÃĐsident. Colonel Lartigaud, vous avez la parole pour votre rapport. Âŧ Le colonel sâavance et sâexprime en des termes dâune clartÃĐ presque brutale. Ses conclusions ? Les quatre victimes dont il vient de faire lâautopsie ont ÃĐtÃĐ tuÃĐes par balles. Le docteur Travail a livrÃĐ Ã la justice de fausses constatations.
Le prÃĐsident rappelle le docteur à la barre : ÂŦ Docteur Travail, vous avez entendu ? Maintenez-vous votre rapport et vos dÃĐclarations ? Âŧ Le prÃĐsident laisse voir sa mauvaise humeur. La maÃŪtrise des dÃĐbats lui ÃĐchappe à cause dâun mÃĐdecin pied-noir incapable de bien ficeler ses examens. Le procÃĻs tel quâil lâavait tracÃĐ, pour lui et pour lâhistoire, sâengage sur une voie hasardeuse.
Coup de thÃĐÃĒtre. Le docteur Travail bÃĐgaieâĶ Il reconnaÃŪtâĶ Il sâest trompÃĐâĶ Il nâa pas de certitudesâĶ Le colonel lÃĐgiste a probablement raisonâĶ Il sâexcuseâĶ LÃĐo et moi fonçons, en nous relayant. ÂŦ Quel crÃĐdit accorder au reste de votre rapport ? Aux autopsies des autres victimes ? Comment vÃĐrifier la force probante des aveux des accusÃĐs si lâon ignore à quelle victime et à quelle mort ils se rapportent ? â Je ne sais plusâĶ Je ne sais plusâĶ Âŧ Le docteur Travail sâeffondre. ÂŦ Jâai mÃĐlangÃĐ les fiches des cadavres. Jâen ai ÃĐgarÃĐ quelques-unes, jâai dÃŧ en dÃĐduire dâautres. Âŧ Le visage gris, la silhouette brusquement rÃĐtrÃĐcie, il quitte la salle. En quelques heures, lâaffaire lâa transformÃĐ en un irrÃĐmÃĐdiable vieillard.
Le 4 mars 1958 au matin, le commissaire du gouvernement prononce son rÃĐquisitoire. Il commence par ÃĐvoquer ÂŦ les bandes sanguinaires semant autour dâelles le meurtre et lâincendie Âŧ et leur ÂŦ long cortÃĻge dâatrocitÃĐs pour ces nombreuses familles qui voulaient vivre en AlgÃĐrie dans la confiance et dans la paix Âŧ. Il lance un vibrant : ÂŦ Nous nâoublierons jamais nos morts dâEl Halia, les enfants surtout. Âŧ Frissons dans la salle. Il cite Montaigne, Camus, et enchaÃŪne en demandant au tribunal la mort pour neuf accusÃĐs.
LâaprÃĻs-midi, nous invoquons la nullitÃĐ des aveux et dÃĐnonçons lâusage de la torture : ÂŦ Ne nous livrons pas à une cÃĐrÃĐmonie expiatoire. Il ne sâagit pas de venger des morts innocents. La force de la France ne se confond pas avec la rÃĐpression. Rien ne peut Être retenu de cette enquÊte entachÃĐe de violence et de trucage. Il faut acquitter. Âŧ
Enfin, le rituel : ÂŦ AccusÃĐs, levez-vous ! Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre dÃĐfense ? Âŧ DerniÃĻre occasion pour ces hommes de faire entendre leur voix. Ils nâauront plus jamais eux-mÊmes la parole, quels que soient les procÃĐdures et les recours. Les larmes aux yeux, certains redisent lâinnocence et la violence. Dâautres secouent la tÊte en silence.
Lâattente dura prÃĻs de douze heures. La salle se remplit dÃĻs vingt heures trente. Les Philippevillois se sont habillÃĐs pour cette sortie aprÃĻs dÃŪner. Le couvre-feu a ÃĐtÃĐ levÃĐ pour le prononcÃĐ du jugement. Ils arrivent par groupes, sâinstallent sur les bancs de bois du prÃĐtoire, sâinterpellent, se reconnaissent. Quelques commentaires, ÂŦ ils vont payer les salauds Âŧ, ÂŦ ces monstres, à la casserole ! Âŧ, quand nous passons devant eux. Un homme ÃĐpais et rougeaud se lÃĻve et me crache à la figure. La femme assise prÃĻs de lui ponctue : ÂŦ Et sâils sâen sortent, on aura votre peauâĶ Âŧ
Le prÃĐsident, ses galons et son dossier apparaissent. Il dÃĐpose son kÃĐpi sur le bureau : ÂŦ Au nom du peuple français Âŧ, proclame-t-il. Pas un souffle dans la salle, tout entiÃĻre debout, comme hypnotisÃĐe par la voix du prÃĐsident. Le nez dans ses papiers, il psalmodie. ÂŦ Condamne le civil musulman X à la peine de mortâĶ Condamne le civil musulman Y à la peine de mortâĶ Âŧ Un glas. Je compte les tÊtes qui tombent, trois, quatre, cinqâĶ, neufâĶ Lâaccusation en avait demandÃĐ neuf. La voilà exaucÃĐe.
Mais le prÃĐsident continue sa lecture. Erreur, il doit y avoir erreur. Je ne comprends pas. Onze, douze. ÂŦ Condamne le civil musulman Z Ã la peine de mortâĶ Âŧ LÃĐo me regarde, trÃĻs pÃĒle. Treize, quatorze, quinze. Quinze de ces hommes avec lesquels nous avons vÃĐcu ces derniers jours vont mourir. Un seul acquittement. Pas de surprise, il ÃĐchoit au mouchard qui reconnut les faits et accusa tous ses compagnons. Des applaudissements saluent le verdict.
Presque minuit. La foule, massÃĐe devant le tribunal, veut ÂŦ nous faire notre fÊte Âŧ. Les gardes nous raccompagnent. Nous sortons par une petite porte latÃĐrale. MalgrÃĐ cela, certains excitÃĐs nous retrouvent, nous bousculent, nous hurlent des injures au visage, veulent nous entraÃŪner. Les CRS nous maintiennent dans la houle et nous ouvrent la voie. LÃĐo monte dans une Jeep, moi dans une autre. Mes gardes du corps me reconduisent jusque dans ma chambre et me recommandent de nâen plus bouger avant le lendemain, dix heures. Ils viendront nous chercher pour le dÃĐpart. Le matin, nous sommes conduits, sous protection militaire, au petit aÃĐroport de Philippeville.
AprÃĻs lâannulation de ce verdict pour vice de forme, un second procÃĻs, fin 1958, acquittera tous les accusÃĐs à lâexception de deux dâentre eux, à nouveau condamnÃĐs à mort. En mai 1959, GisÃĻle Halimi et LÃĐo Matarasso obtiendront du gÃĐnÃĐral de Gaulle quâil les gracie. Mais bon nombre dâacquittÃĐs, maintenus en dÃĐtention, seront assassinÃĐs par des partisans de lâAlgÃĐrie française.
GisÃĻle Halimi
Avocate (1927-2020). Ce texte est extrait de son livre Le Lait de lâoranger, ÂĐ Ãditions Gallimard, Paris, 1988.